
|
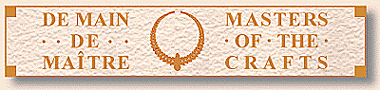
LAURÉATE EN 1978
Lois Etherington Betteridge - Orfèvre
À propos de l'artiste
|

|
« Créer de beaux objets pour des fonctions particulières et
importantes est pour elle une façon de rendre hommage à la
culture et aux rites ancestraux. C'est le but que Lois Betteridge s'est
fixé et c'est aussi ce qui explique la fascination que son art
exerce sur nous. Ses œuvres, qu'elles soient d'inspiration organique
ou géométrique, demeurent toujours romantiques et
relèvent essentiellement de l'émotion. Elles rendent compte
des liens qui nous unissent au monde. Elles s'adressent à chacun
de nous et à nous tous dans le cadre des célébrations
de nature publique ou privée où elles sont utilisées.
Lois Betteridge structure tous les éléments de son travail
en fonction de l'acte de servir et du plaisir d'en découvrir la
dimension symbolique. Les rapports de l'œuvre avec sa fonction, avec
des rites et des célébrations, et tous les aspects de son
décor et de sa forme, évoquent le toucher et le sentiment.
Un lien romantique est établi. Cet idéal du beau, d'une
unité harmonieuse entre l'objet et sa fonction, est celui de Lois
Betteridge. »
Carole Hanks
Professeur d'histoire de l'art et du design
Sheridan College
Oakville (Ontario)
|

|
Jusqu'à il y a une quarantaine d'années, il n'y avait qu'une
seule façon de devenir maître-artisan : faire son
apprentissage. Depuis, les collèges et les universités du
Canada et des États-Unis ont mis en place des structures de
formation des artisans. Sous l'influence du Bauhaus, ils ont
créé des programmes interdisciplinaires d'art et d'artisanat
où artistes, designers et maîtres-artisans montrent aux
étudiants les gestes et les matériaux de leur métier.
Ce décloisonnement des disciplines a montré que,
contrairement aux idées reçues, les métiers d'art ne
sont pas enfermées dans leur propre esthétique et dans les
considérations commerciales. Au contraire, l'acquisition de
nouvelles maîtrises et la redécouverte des techniques
ancestrales sont stimulées par l'environnement créatif de
l'université.
|
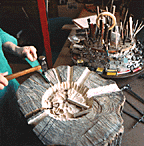
|
Lois Etherington Betteridge a découvert sa vocation juste
après la guerre. Le monde retrouveait sa grande soif de savoir et
l'orfèvrerie venait d'être inscrite au programme de
l'université. Elle se souvient que le mouvement
« commençait tout juste aux États-Unis. L'université
du Kansas avait la première pris l'initiative lorsque j'étais
étudiante en deuxième année là-bas. Je ne
savais même pas que l'orfèvrerie existait avant de m'inscrire.
J'ai commencé à en faire dans le cadre de mes cours de
design. »
|

|
Certaines des techniques et des attitudes des guildes se retrouveaient
dans l'enseignement universitaire, mais on n'exigeait plus que les
élèves se cantonnent dans telle ou telle tâche
précise. Cette évolution trahissait l'influence du design
industriel scandinave (dans les pays nordiques, l'artisan fabriquait
l'objet du début à la fin). Grâce à elle, les
élèves se familiarisèrent avec toutes sortes de
techniques. C'est ainsi par exemple que Betteridge découvrit la
valeur fonctionnelle du design de l'objet en creux (dressé au
marteau), qui exige aussi bien la maîtrise de l'outil et du geste
que la connaissance des matériaux traditionnels.
|

|
Nécessaire à communion particulier, 1965
Argent fin
Formé, assemblé
Boîte en bois ajustée par H.M. Forster,
Ruislip (Middlesex), Angleterre
20,4 cm x 20,2 cm x 20,1 cm
MCC 86-104.1-11
Don de l'artiste
|

|

|
Écritoire, 1977
Argent fin, stéatite, pointe de plume en or
Formé, ciselé, monté, sculpté
Encrier : 16,9 cm x 8,2 cm diamètre
Plume : 18,7 cm x 1,2 cm diamètre
Support : 18,5 cm x 14,9 cm x 2,4 cm
MCC 86-102.1-3 (Bronfman)
|

|
|
Elle passa les dix années suivantes à parfaire et à
explorer les multiples techniques du métier : repoussé,
ciselage, cire perdue, incrustations en ébène, en corne et
en pierres précieuses. Des clients des secteurs privé et
public lui demandèrent de fabriquer de l'argenterie et des objets
de culte; ces commandes étaient, confie-t-elle, autant de
défis « car il fallait rendre sculptural un objet fonctionnel, sans
pour autant faire une sculpture ».
|

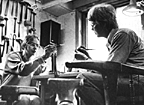 |
Lois Betteridge travaillant avec une
élève à son atelier d'Ottawa, 1976
|

|
|
L'orfèvrerie est un métier d'art éminemment
traditionnel qui reste pourtant en questionnement perpétuel. Ainsi
Lois Betteridge, comme ses pairs et ses cadets, s'interroge souvent sur la
pertinence de l'objet non utilitaire dans l'orfèvrerie
contemporaine. L'application des techniques modernes et l'utilisation de
matériaux synthétiques — matières plastiques,
céramiques artificielles — sont aussi fort
controversées. Ces innovations préoccupent d'ailleurs Lois
Betteridge. Elle craint en effet que le savoir-faire et le métier
traditionnels cèdent le pas aux solutions de facilité : « On
ne soude plus, on pose un boulon. »
Forte de convictions, Lois Betteridge reste très présente
sur la scène internationale de l'orfèvrerie. Elle enseigne
dans son studio et participe à des ateliers. Le statut professionnel
qu'elle a réussi à conquérir montre aux futurs
orfèvres qu'il est encore possible aujourd'hui de faire
carrière en orfèvredir traditionnelle.
|

