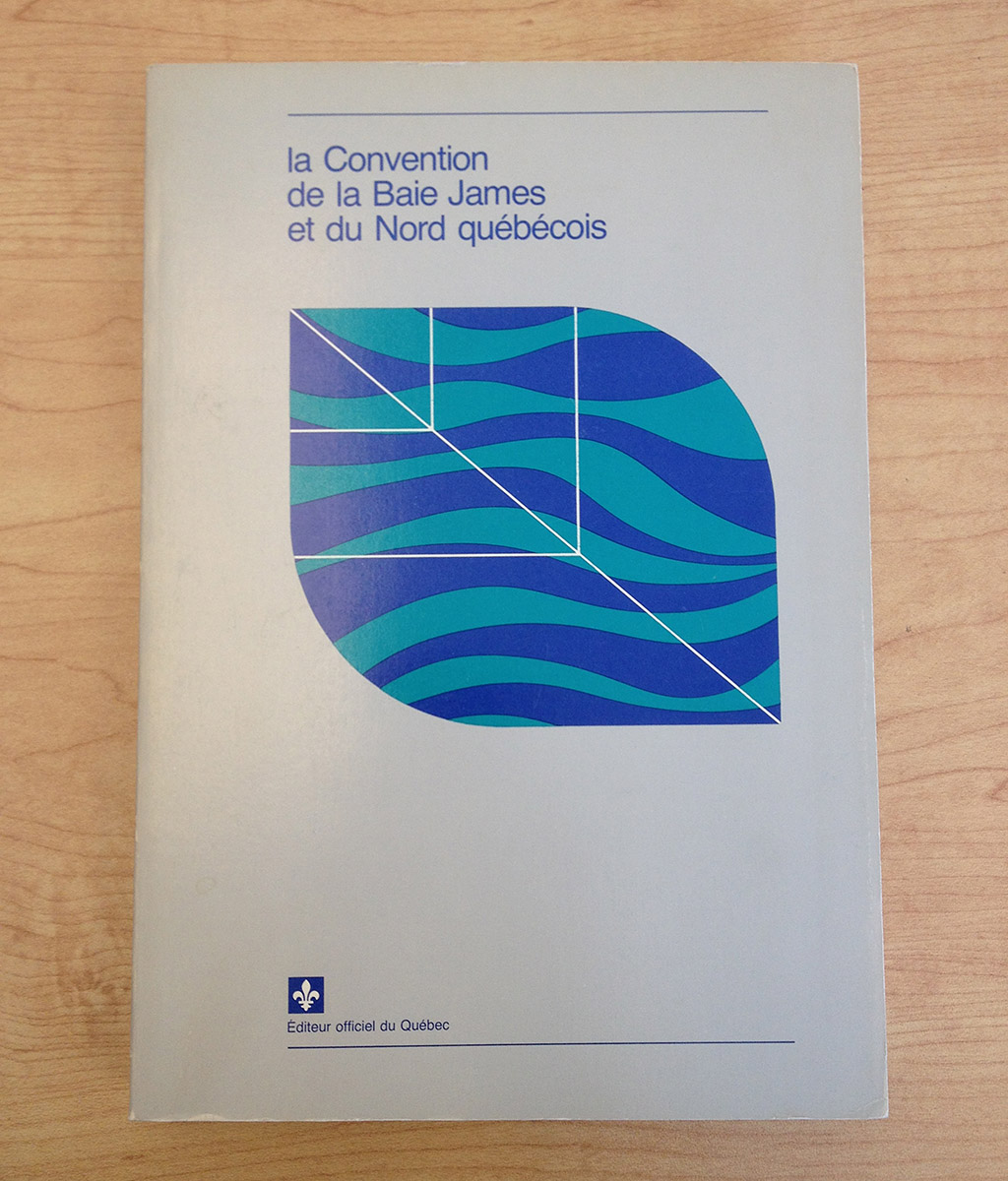Pour les Québécois des années 1960, nationaliser l’hydro-électricité représente plus qu’une décision économique. C’est l’affirmation d’une fierté nationale. Durant la campagne électorale de 1962, le chef libéral Jean Lesage propose de fusionner toutes les sociétés privées en une seule entité : Hydro-Québec. Son ministre René Lévesque est l’apôtre infatigable du projet. Les libéraux sont réélus et le gouvernement procède rapidement à la nationalisation.
La construction du barrage Manicouagan 5, dit Manic-5 , demeure un exploit technologique. C’est le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts au monde. Long de 1314 mètres, haut de 215 mètres à son sommet, il pèse 5,5 milliards de kilogrammes. Ses 13 voûtes sont colossales : un édifice de 45 étages entrerait confortablement dans son arche principale. C’est aussi un exploit national : les travaux se sont déroulés essentiellement en français – signe de fierté.
Une monument de fierté
Manic-5, c’est le symbole d’une nouvelle confiance en soi pour les francophones du Québec. Le chantier attire des visiteurs de prestige : chanteurs, dessinateurs, dignitaires étrangers. « La Manic » entre dans la culture populaire. C’est, par exemple, le titre d’une chanson d’amour inoubliable. Oui, Manic-5, c’est plus qu’un simple barrage.

2.Disque 45-tours, « La Manic »
Donald Lautrec (paroles et musique de Georges Dor), 1966
MCH, Archives audiovisuelles, AV2016-0108, DISC 3704
Georges Dor - Quebec Love - La Manic
La Baie-James
Le « projet du siècle » est annoncé fièrement le 30 avril 1971 par le nouveau premier ministre du Québec, Robert Bourassa. « Le monde commence aujourd’hui », clame-t-il. Le projet de la Baie-James représente un effort financier de plusieurs milliards de dollars et génère plus d’énergie que toutes les centrales de la Belgique, par exemple.
Un premier traité
Le projet de la Baie-James est lancé sans consulter les populations autochtones du territoire. À la suite de protestations, en 1973, le jugement Malouf, de la Cour supérieure du Québec, décrète qu’un accord avec les habitants ancestraux est impératif. Le 15 novembre 1974, on signe l’entente de principe entre le gouvernement du Québec, ses organismes énergétiques, le Grand Conseil des Cris, les Inuit du Québec et le gouvernement du Canada. C’est le premier traité contemporain sur les droits territoriaux autochtones au Canada.