VISITE COMPLÈTE
Le processus de
conception -
LA COLLECTE DE
RENSEIGNEMENTS
Le jour fixé pour la
présentation des projets des architectes, le Groupe
d'étude sur les nouveaux locaux achevait la
première phase de ses travaux. En collaboration avec les
Services d'architecture des Musées nationaux, le MCC
publiait la première version d'un programme
d'architecture. Celui-ci définissait :
- le mandat, les objectifs, l'histoire, les fonctions, le
public et la structure organisationnelle du Musée;
- le projet immobilier;
- l'utilisation du terrain (accès, sécurité
et aménagement paysager);
- les exigences générales en matière de
construction (par exemple, image, fonctionnalité,
circulation, conservation, sécurité);
- et, sommairement, chacune des principales aires de
l'édifice, en précisant leurs fonctions, les
dimensions à respecter et les locaux qui devaient
être adjacents.
Le programme d'architecture,
deuxième version.
© Musée canadien des civilisations, D2004-18590, CD2004-1377
|

|
Le document était rédigé en grande partie
par des experts du MCC en collaboration avec le groupe
d'étude. Celui-ci se divisa en deux sous-groupes :
le groupe des programmes publics et le groupe de la conservation
et des services, dont relevaient douze équipes
chargées des questions suivantes :
- éducation et interprétation;
- commodités pour les visiteurs;
- salles nécessaires;
- thèmes à exploiter;
- sécurité et protection contre les incendies;
- conservation;
- réserves;
- réserves ouvertes;
- bureaux et locaux de travail;
- entretien et exploitation de l'immeuble;
- centre de documentation;
- et techniques de pointe.
Afin d'avoir une idée des attentes de la
communauté muséale à l'égard du
nouveau musée, le groupe d'étude distribua en
juillet 1982 quelque 1 400 questionnaires et guides du
musée, au Comité consultatif, au Conseil
d'administration, à l'Association des musées
canadiens et à d'autres intéressés. En
octobre 1983, le programme d'architecture était
redéfini dans une deuxième version en quatre gros
volumes de plus de 1 200 pages. Ceux-ci expliquaient plus
en détail les exigences en matière de locaux, de
conservation, de sécurité et de systèmes de
communication. Ils présentaient en outre un profil des
visiteurs.
Mais la réalisation d'un grand musée est une
entreprise complexe et exigeante. Il ne s'agit pas simplement de
définir un programme, puis d'exécuter les dessins
et de construire l'édifice. Dans le cas du MCC, ce fut
dans une large mesure un processus interactif. Pour Cardinal, il
était primordial qu'un dialogue suivi s'engage entre les
architectes et le personnel du Musée. Le personnel du MCC
définissait d'abord un canevas (le programme
d'architecture) à partir duquel l'architecte
réalisait un modèle et des plans. Ceux-ci
étaient ensuite soumis à l'analyse et à la
critique du MCC. Après quoi ils étaient
révisés puis soumis à un nouvel examen, et
ainsi de suite.

Douglas Cardinal (à gauche)
démontre son imprimante de plan du site à Jean
Boggs, directrice générale de la
Société de construction des musées du
Canada, Francis Fox, ministre des Communications, Léo
Dorais, secrétaire général des
Musées nationaux du Canada et George MacDonald, directeur
du MCC.
© Douglas J. Cardinal Architect Ltd.
|
Les deux parties tiraient profit de ces échanges. Le
personnel du Musée et les architectes apprenaient
à exprimer et à voir les choses dans la même
perspective, et ainsi, à mieux définir les
besoins. Ce dialogue, en fait, faisait partie intégrante
de la démarche professionnelle de Cardinal : il
permettait à des personnes qui connaissaient bien les
musées « de l'intérieur »
d'exprimer leurs points de vue en détail et d'orienter
ainsi le travail créateur de l'architecte. C'est ainsi
que les premières ébauches du projet - celles
de l'architecte et celles du personnel du MCC - ont
naturellement évolué dans le sens d'une meilleure
adaptation au milieu.
C'est encore là une description assez simple. Le nombre
de parties intéressées peut donner une idée
de la complexité du projet:
- En premier lieu viennent les architectes et le personnel du
MCC. Malgré certains désaccords
compréhensibles vu la complexité du projet, les
deux groupes se sont toujours efforcés de comprendre
leurs points de vue respectifs et ont entretenu des relations en
général harmonieuses.
- D'autres composantes des Musées nationaux - en
particulier les Services d'architecture, les Services de
sécurité et l'Institut canadien de
conservation - ont contribué au programme
d'architecture.
- La GRC a été consultée sur les
questions de sécurité et le Commissaire
fédéral des incendies ainsi que des experts
provinciaux et municipaux ont aidé à définir
la protection nécessaire.
- Travaux publics Canada a fourni des renseignements techniques
concernant l'entretien de l'immeuble et les dimensions des
locaux, tandis que la Commission de la capitale nationale a
précisé les critères à respecter
pour que l'édifice soit conforme aux objectifs
fédéraux relatifs à l'aménagement du
« cœur » de la Capitale nationale.
- De nombreux consultants ont apporté leur aide dans
les domaines suivants : normes de construction
mécanique, plans des laboratoires, éclairage,
transports verticaux, aménagement paysager, acoustique,
etc. L'industrie a également été
consultée au sujet de certains produits tels que les
étagères mobiles à grande capacité
et les niveleurs de quais.
- Enfin, la Société de construction des
musées du Canada coordonnait l'ensemble des travaux.
Le personnel du MCC a poussé encore plus loin ses
recherches en visitant (ou en consultant par
téléphone ou par lettre) d'autres musées et
organismes culturels, récréatifs et
éducatifs du Canada et de l'étranger. Le MCC ne
s'inspire d'aucun établissement en particulier. Il
réunit plutôt des caractéristiques
empruntées à divers établissements de
façon progressive. Parmi les influences les plus
anciennes, citons :
- l'orientation régionale du Musée
d'anthropologie de Mexico et l'importance qu'il accorde à
la culture autochtone;
- la participation d'Autochtones aux programmes du
Musée d'anthropologie de l'université de la
Colombie-Britannique;
- les musées pour enfants de Boston et d'Indianapolis;
- les remarquables techniques d'exposition du British Columbia
Provincial Museum et certains éléments du Museum
of American History (Smithsonian Institution);
- le programme de renouvellement des expositions du British
Museum;
- les reconstitutions environnementales de ce dernier
musée et celles du York Castle Museum, du Milwaukee
Public Museum et, en général, des musées en
plein air;
- les expositions interactives sur les sciences, notamment
à l'Exploratorium de San Francisco;
- les fascinantes utilisations de l'espace dans des
musées de Santa Barbara, de Nagoya et d'Otami (Japon), et
l'application générale de la nouvelle technologie
dans de grands musées du Japon;
- les techniques innovatrices utilisées dans des
centres culturels comme le parc de la Villette, et le Centre
Pompidou en France, à Expo 85 et Expo 86, et au Centre
Epcot.
À partir de ces éléments, le MCC voulu
réaliser une synthèse, un modèle nouveau
particulier à l'expérience canadienne
et conçu pour un public très varié.
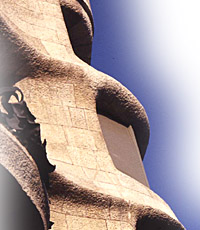 
Les propres influences de M. Cardinal
comprennent le travail visionnaire de l'architecte moderniste
Antoni Gaudi. M. Cardinal a eu l'occasion de voir directement
les œuvres du début du XXe siècle
de cet architecte à Barcelone, grâce au Groupe
d'étude sur les nouveaux locaux. Les terrasses
courbées du pavillon administratif évoquent les
formes de la Casa Mila de Gaudi.
© George F. MacDonald
|

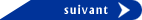
|