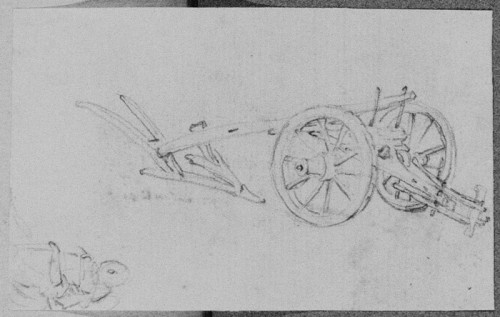-
- Introduction
- Colonies et Empires
- Les explorateurs
- Jacques Cartier 1534-1542
- Samuel de Champlain 1604-1616
- Étienne Brûlé 1615-1621
- Jean Nicollet 1634
- Jean de Quen 1647
- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660
- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660
- Nicolas Perrot 1665-1689
- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687
- Charles Albanel 1672
- Jacques Marquette 1673
- Louis Jolliet 1673-1694
- Louis Hennepin 1678-1680
- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679
- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689
- Pierre de Troyes 1686
- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702
- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701
- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739
- Activités économiques
- Population
- Vie quotidienne
- Héritage de la Nouvelle-france
- Liens utiles
- Crédits
Population
Immigration
Pour développer une colonie outre-mer, il faut avant tout la peupler. Il s’agit même d’un des éléments décisifs pour la survie d’une colonie. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui ont décidé de venir en Amérique pour y entreprendre une nouvelle vie ou qui y ont été envoyés sans qu’on leur demande leur avis? En d’autres termes, qui étaient les ancêtres des Québécois et, de façon générale, de toutes les populations francophones vivant en Amérique du Nord aujourd’hui?
Cette question n’intéresse pas uniquement les généalogistes; les historiens et les sociologues aussi cherchent à savoir à partir de quelles populations s’est constitué le peuple de la Nouvelle-France. Savoir qui étaient les colons et d’où ils venaient permet, entre autres choses, de mieux appréhender la manière dont se sont développées cette civilisation et cette culture nouvelle qui se sont maintenues jusqu’à aujourd’hui.
Lorsqu’on parle du peuplement de la Nouvelle-France, on évoque souvent les « filles du roi », de jeunes filles envoyées par Louis xiv et son ministre Colbert pour qu’elles se marient avec des célibataires déjà installés dans la colonie. Toutefois, de nombreuses autres personnes ont quitté leur pays pour la Nouvelle-France. Dans l’article qui suit, Leslie Choquette révèle tout au sujet des colons. Qui étaient-ils? D’où venaient-ils? Combien étaient-ils? Quel âge avaient-ils? Pourquoi décidaient-ils de tout abandonner pour affronter les dangers d’une traversée? Quels étaient leurs métiers?
Sources et parcours (afficher)
La colonisation de la Nouvelle-France s’inscrit dans une migration transatlantique qui, du XVIe au xixe siècle, amènera environ 3 millions d’Européens et 12 millions d’Africains en Amérique. La France, le pays le plus peuplé d’Europe à l’époque, laisse pourtant partir moins d’habitants que l’Espagne, le Portugal ou les îles Britanniques. Quelques centaines de milliers de Français seulement émigrent et, de ce nombre, à peine quelques dizaines de milliers arrivent en Nouvelle-France, la plupart préférant se rendre dans les colonies des Antilles, réputées plus riches. Ce peuplement restreint donne quand même naissance à des sociétés distinctes dans l’ensemble des territoires qui forment la Nouvelle-France : le Canada (la vallée du Saint-Laurent), l’Acadie, le Pays d’en haut (les Grands Lacs) et la Louisiane (la vallée du Mississippi). Qui sont ces pionniers? Pourquoi sont-ils venus et combien sont-ils? Mais d’abord, comment fait-on pour les étudier?
D’où viennent les renseignements sur les immigrants?
« Nos ancêtres, au XVIIe siècle, ont quitté l’anonymat en franchissant l’Atlantique. » Cette affirmation du démographe québécois Hubert Charbonneau témoigne de la richesse des sources qui documentent la vie des immigrants français en Nouvelle-France, avant et après leur traversée de l’océan. Du côté français, les documents concernent surtout les départs : listes de passagers, rôles d’embarquements militaires, contrats d’engagement. En Nouvelle-France, les documents les plus pertinents sont les registres administratifs tenus par l’Église et l’État avec une telle précision que, selon Charbonneau, « aucune autre population pionnière ne peut être étudiée avec une telle minutie, du moins pour une époque aussi reculée, que ce soit en Nouvelle-Angleterre, au Brésil ou en Amérique espagnole ». Les immigrants français arrivés en Nouvelle-France, malgré leur petit nombre, sont essentiels à la compréhension de la colonisation européenne des Amériques.
Les sources françaises
Les rôles d’embarquements militaires, les contrats d’engagement et les listes de passagers, malgré un état de conservation qui laisse parfois à désirer, sont d’excellentes sources d’information sur les départs d’immigrants vers la Nouvelle-France.
Les soldats et les officiers français sont une composante primordiale du courant migratoire transatlantique. En effet, plus de 13 000 militaires s’embarquent pour le Canada pendant le Régime français. Même s’ils ne s’établissent pas tous en Amérique du Nord, ils contribuent énormément au succès de la colonisation par la France. Les rôles d’embarquements ne concernent qu’une minorité de ces militaires mais, parmi eux, les listes les mieux tenues désignent les hommes par leur nom et leur surnom, ou nom de guerre, leur âge, leur taille (il fallait faire cinq pieds), leur profession et leur lieu d’origine.
Un soldat de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France
Joseph Galles dit Léveillé s’engage dans la compagnie d’Estorc du régiment Royal-Roussillon le 1 avril 1745. Selon le rôle dressé en 1749, ce fils d’André Galles et d’Isabelle Escaud est natif de la ville de Monsempron en Agenais (Monsempron-Libos dans le Lot-et-Garonne). Il a 21 ans et exerce le métier de cordonnier. Voici son signalement : « Taille de 5 pieds 2 pouces 4 lignes, cheveux châtains, sourcils noirs, visage brun, yeux roux, nez large, un peu marqué de petite vérole ». Joseph ne rentre pas en France après la Conquête et épouse Joséphine Denis dite Véronneau à Boucherville en 1760. Il décède à Varennes en 1813.
La majorité des immigrants qui ne viennent pas avec l’armée sont des engagés trop pauvres pour payer leur passage outre-mer. Pour financer leur voyage, ils passent un contrat avec un employeur dans la colonie, acceptant de le servir pendant trois ans, d’où l’autre nom de l’engagé, le « trente-six mois ». En échange, ce dernier est logé, nourri, rémunéré et transporté gratuitement en Nouvelle-France. Une fois son temps écoulé, il est libre de retourner en France, parfois aux frais de l’ancien employeur, ou de prolonger son séjour dans la colonie.
Un engagement pour le Canada en 1727
Le 15 mai 1727, Jean Lemoyne s’engage dans le port de La Rochelle pour aller servir les religieuses hospitalières de Québec pendant trois ans. Selon son contrat d’engagement, il est âgé de 20 ans, jardinier de son état et natif de Noyal, dans le diocèse de Vannes, en Bretagne. Les religieuses l’embauchent comme jardinier aux gages de 100 livres par an, payables en argent, ainsi qu’un pot d’eau-de-vie par mois, mesure de Paris, dont il disposera à sa volonté. Elles ne paient que l’aller, mais au cours de son service, Lemoyne sera nourri, vêtu et entretenu selon son état, en santé et en maladie. Avant de s’embarquer, il sera habillé d’un habit de bonne étoffe, avec justaucorps, veste et deux culottes.
Les listes de passagers informent à la fois sur les engagés qui s’embarquent et sur les voyageurs qui paient eux-mêmes leur traversée. Les meilleures listes, comme celles du port de Saint-Jean-de-Luz, dans le Sud-Ouest de la France, livrent le nom, le lieu de naissance, le métier et l’âge de chaque voyageur en plus des raisons qui le poussent à entreprendre le voyage. La plupart des gens partent pour « travailler de leur profession ou état ».
Les sources nord-américaines
En Nouvelle-France, on obtient le nom des nouveaux venus grâce aux registres d’état civil tenus par l’Église et dans certains documents de l’État, comme les recensements et les archives notariales et judiciaires. Parmi les registres d’état civil, les actes de mariage sont de première importance pour l’historien de l’immigration : ils fournissent l’origine géographique des époux et parfois leur métier et celui de leurs parents. Au Canada, l’acte de mariage est précédé d’un « témoignage de liberté au mariage » dès 1757, époque où de nombreux soldats de la guerre de Sept Ans commencent à s’établir au pays. Le témoignage est une déclaration sous serment, corroborée par des témoins dans la mesure du possible, attestant que l’immigrant est libre de se marier.
Enfin, les recensements et les documents notariaux et judiciaires contiennent beaucoup d’informations sur les immigrants et leurs activités. Par exemple, le premier recensement tenu au Canada, en 1666, indique tous les métiers pratiqués par les habitants avant leur départ de France. Dans les archives notariales, les contrats de mariage valident ou complètent les données trouvées dans les actes de mariage. Les archives judiciaires, pour leur part, permettent de connaître l’histoire de certains immigrants infortunés. Ainsi, à Louisbourg, l’interrogation d’un Français inculpé inclut les questions suivantes. De quelle profession est son père et quel métier l’accusé pratiquait-il en France? Pourquoi est-il venu en cette île? Avec qui se tenait-il et à quel moment est-il arrivé? Où a-t-il été engagé et par qui? Qu’est-ce qui l’a obligé à s’engager?
L’historien de l’immigration française en Nouvelle-France travaille donc à partir d’un corpus documentaire très riche provenant des deux côtés de l’Atlantique.
Combien de Français sont venus en Nouvelle-France? (afficher)
Cette question, en apparence si simple, a donné lieu à de nombreux débats. Pendant longtemps, les historiens ont estimé à environ 10 000 les immigrants venus sous le Régime français. Cette estimation repose toutefois sur une définition très étroite de l’immigration. Elle ne correspond ni à la migration brute ni à la migration nette, mais plutôt à ce qu’on appelle « l’immigration fondatrice ». Or, les immigrants fondateurs sont ceux qui, selon le démographe Mario Boleda, ont établi « des familles nombreuses constituant ce qui allait devenir le noyau de la population québécoise ». Cette définition implique non seulement l’établissement permanent des colons, mais aussi leur reproduction. D’ailleurs, sa portée se restreint à la vallée du Saint-Laurent et exclut les établissements français dans les Maritimes et en Louisiane.
Si on adopte une définition plus large de l’immigration pour comprendre les migrants temporaires, tels les engagés et les soldats qui sont retournés en France, le résultat est très différent. Mario Boleda propose deux nouvelles estimations de l’immigration au Canada. Ce qu’il appelle « l’immigration observée », c’est-à-dire la partie du mouvement migratoire que l’on peut repérer dans les documents, s’élève à environ 33 500 personnes, tandis que la migration nette, calculée selon des techniques démographiques, se chiffre à quelque 20 000 personnes. D’ailleurs, des milliers d’immigrants, le plus souvent des migrants temporaires, s’acheminent vers les Maritimes; le généalogiste Marcel Fournier estime leur nombre à environ 7 000. La Louisiane, pour sa part, reçoit 7 000 immigrants européens et 7 000 esclaves africains au début du XVIIIe siècle.
Qui sont les immigrants et les immigrantes? (afficher)
La répartition selon le sexe
À ses débuts, la colonisation de la Nouvelle-France est une affaire d’hommes. Quand Champlain fait construire ses premières « habitations » en Acadie (1604-1605) et à Québec (1608), ses compagnons sont tous de sexe masculin. Pourtant, il n’y a pas de colonisation sans femmes. Champlain envisage d’abord de franciser les Autochtones afin de créer une population coloniale de sang métis et de culture française. Son projet n’aboutissant pas, les autorités font venir des femmes.
La première immigrante, Marguerite Vienne, qui accompagne son mari à Québec en 1612, meurt peu après son arrivée. C’est donc en 1613 que s’embarquent les vraies pionnières : Marie Rollet, la femme du colon Louis Hébert, et leurs deux filles, Guillemette et Anne. En Acadie, les premières femmes arrivent en 1636, avec neuf ménages français.
En tout, on compte environ 2000 femmes et filles parmi les 10 000 immigrants fondateurs du Canada. En font partie les filles du roi, les quelque 850 jeunes filles envoyées à Québec au milieu du XVIIe siècle pour qu’elles se marient à des hommes de la colonie.
Les origines géographiques
L’origine géographique des immigrants reflète l’importance de la France atlantique dans le courant migratoire. Plus des deux tiers des colons canadiens et acadiens viennent de la côte atlantique, considérée dans un sens très large. Sur une carte, une ligne imaginaire, tracée depuis Rouen jusqu’à Toulouse, sépare une France de l’Ouest étroitement liée à la Nouvelle-France d’une France de l’intérieur, qui participe moins au mouvement migratoire. Plus précisément, 39 p. 100 des immigrants viennent du Nord-Ouest, 19 p. 100 du Centre-Ouest, et 11 p. 100 du Sud-Ouest.
Malgré cette répartition inégale, l’aire de recrutement englobe toute la France : les immigrants viennent de chaque province, voire de chaque département actuel du pays, à l’exception de la Corse. Il en vient 9 p. 100 de l’Est, autant de la région parisienne, 3 p. 100 de chacun des départements de la Loire, du Nord et du Massif central, 2 p. 100 du Midi et 1 p. 100 des Alpes. Enfin, seulement 1 p. 100 d’étrangers s’embarquent pour la Nouvelle-France.
Si l’on tient compte des seuls immigrants fondateurs du Canada, les résultats sont quelque peu différents. Le pourcentage d’entre eux venant du Nord-Ouest baisse à 28 p. 100, en faveur du Centre-Ouest et de la région parisienne. En effet, du Nord-Ouest part un nombre relativement élevé d’immigrants temporaires, notamment de la Bretagne, tandis que le Centre-Ouest et l’Île-de-France fournissent un pourcentage plus élevé de pionniers et de pionnières, c’est-à-dire d’immigrants qui demeurent au pays.
L’origine urbaine des immigrants est particulièrement prononcée : près des deux tiers viennent des villes. Parmi ces derniers, les deux tiers également viennent de grandes villes de plus de 10 000 habitants. L’immigration coloniale, aux XVIIe et XVIIIe siècles, se distingue donc nettement de l’exode transatlantique du siècle suivant. En effet, pendant ces deux siècles, ce sont des résidants de villages, de bourgs et surtout de villes qui vont s’établir sur des terres, alors qu’au siècle suivant ce sont des paysans de l’Ancien Monde qui sont subitement introduits dans des environnements urbains tumultueux. La ville qui a fourni le plus grand nombre d’immigrants est La Rochelle puis, en ordre décroissant, Paris, Saint‑Malo, Rouen, Nantes, Dieppe et Bordeaux, ce qui reflète clairement le caractère à la fois atlantique et urbain du mouvement.
Les immigrants d’origine rurale viennent généralement de campagnes prospères, au réseau de transport développé et à l’agriculture bien intégrée aux économies de marché. Dès l’Ancien Régime, ces paysans participent à une économie ouverte sur les circuits atlantiques où circulent biens et personnes.
Les origines sociales et professionnelles
Les origines professionnelles des immigrants sont difficiles à cerner. Les sources sont parfois lacunaires à ce sujet. Néanmoins, le jumelage des informations sur les origines sociales à celles sur les origines régionales donne des résultats intéressants. Ainsi, les fondateurs du Canada sont trois fois moins souvent des paysans que les Français en général, 27 p. 100 contre 80 p. 100. Par contre, l’élément artisanal constitue près de 45 p. 100 de la population immigrante, un trait caractéristique des grandes villes, telles que Bordeaux, Rouen et Paris, mais non de l’ensemble de la France. Les nobles (3 p. 100), les bourgeois (12 p. 100) et les travailleurs non agricoles (14 p. 100) sont aussi surreprésentés chez les immigrants. À l’exception des militaires, les métiers du bois et du bâtiment, du vêtement et du textile et les métiers maritimes sont les occupations les plus fréquentes. Au strict point de vue des professions, les Français émigrant vers le Canada paraissent beaucoup plus reliés au secteur urbain qu’à « la France profonde ».
La répartition selon l’âge
La répartition des immigrants selon l’âge ne correspond pas à celle de la population française. La structure d’âges d’une population normale ressemble à une pyramide s’effilant des plus jeunes aux plus vieux. Pourtant, celle de la population immigrante s’apparente davantage à une toupie, où les tranches d’âges des plus jeunes et des plus vieux sont sous-représentées.
La jeunesse, à l’exception de l’enfance, est une autre caractéristique des immigrants. Près des trois quarts sont âgés de moins de 30 ans et, parmi eux, moins d’un dixième ont moins de 15 ans, et plus de la moitié ont dans la vingtaine. En somme, les jeunes adultes prédominent.
La migration familiale est plutôt l’exception que la règle. La famille nucléaire compte pour environ un dixième des immigrants, et elle est en général dans les premières années de sa formation. Le recrutement familial est surtout important dans certaines régions, par exemple, le Perche, où des seigneurs déploient des efforts particuliers pour attirer les familles rurales dans leurs seigneuries canadiennes. L’immigration en famille surpasse aussi la moyenne là où les relations avec le Canada sont les plus soutenues, entre autres, dans la région de La Rochelle. Là, en plus de déceler un pourcentage assez élevé de familles nucléaires, on note l’importance des liens de parenté dans le nombre d’immigrants (40 p. 100 d’entre eux) qui accompagnent ou suivent un membre de leur famille.
Les origines religieuses
C’est seulement en matière de religion que les immigrants reflètent la situation en France. Dès 1627-1628, le Canada est une colonie officiellement catholique. Les protestants non convertis, s’ils sont souvent tolérés en tant qu’immigrants temporaires, ne peuvent s’assembler pour l’exercice de leur religion « sous peine de châtiment ». Il y a moins de 300 huguenots parmi les immigrants fondateurs du Canada, et bon nombre d’entre eux se convertissent au catholicisme avant leur arrivée. Plus des deux tiers viennent des provinces du Centre-Ouest, c’est-à-dire de l’Aunis, de la Saintonge, du Poitou et de l’Angoumois. On compte aussi quelques juifs, surtout des conversos qui pratiquent la religion catholique. La Nouvelle-France, à la différence de la Nouvelle-Angleterre, ne devient jamais un refuge pour les minorités religieuses.
Qui dit catholique ne dit pas forcément pieux. Parmi les immigrants laïcs, ni le peuple ni les administrateurs ne sont particulièrement enclins à la dévotion rigoriste. Au contraire, une certaine indifférence populaire se laisse deviner à l’égard de comportements proscrits par l’Église et on a même constaté des cas d’anticléricalisme. L’élite administrative, pour sa part, se trouve souvent aux prises avec des membres du clergé. Le zèle catholique, sans doute important au début de la colonie laurentienne, serait donc surtout le fait de missionnaires pétris des idées de la contre-réforme.
Portrait de l’immigrante
Il importe de rappeler qu’un immigrant fondateur sur cinq au Canada est de sexe féminin. Qui sont ces quelque 2 000 femmes et filles arrivées dans la colonie après un voyage périlleux? D’où viennent-elles et que font-elles dans la vie?
Le premier fait remarquable est l’origine urbaine d’une forte proportion de ces immigrantes. En effet, plus des trois quarts viennent d’une ville, et la majorité d’entre elles, d’une ville importante. Comme chez les hommes, ce fait ne veut pas forcément dire que les immigrantes sont nées en ville, mais qu’elles ont quitté leur campagne avant de s’embarquer pour le Canada.
Le second fait qu’il importe de souligner est l’existence d’une géographie migratoire exclusivement féminine. La majorité des départs féminins se sont faits depuis la moitié nord de la France. Au sud de la Loire, seule la vallée de la Charente voit partir une quantité appréciable de migrantes. Même la région de Bordeaux, qui envoie des milliers d’hommes aux colonies au XVIIIe siècle, ne voit naître que quelques futures Canadiennes.
Cette distribution inégale, où la France septentrionale domine, ressemble à la géographie française de l’alphabétisme sous l’Ancien Régime. On distingue ici aussi deux France : celle du Nord et de l’Est, caractérisée par un pourcentage relativement élevé de personnes sachant signer, et celle qui regroupe la Bretagne, le Massif central et le Midi, à très fort taux d’analphabétisme. Les hommes gagnent le Canada d’un peu partout, mais les femmes quittent surtout des régions où le niveau culturel est le plus élevé.
Comme les hommes, les migrantes sont issues de toutes les couches sociales : noblesse, paysannerie, bourgeoisie, artisanat. Riches ou pauvres, la plupart n’ont cependant pas de profession dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui. Elles se préparent au mariage, ce qui est presque une nécessité économique à une époque où une femme seule assure difficilement sa subsistance. Des 2000 immigrantes, plus des deux tiers sont en état de se marier dès leur arrivée. Il y a une centaine de veuves, mais la plupart sont ce qu’on appelle alors des « filles à marier ». Vingt pour cent ont moins de 30 ans, et la moitié, entre 15 et 25 ans.
Toutes les immigrantes ne sont cependant pas vouées au mariage. Environ une centaine de femmes, mariées ou non mariées, exercent une activité professionnelle : sage-femme, maîtresse d’école et, le plus souvent, missionnaire. Nombre d’éducatrices viennent à titre de missionnaires, dont la plus connue est sans doute Marguerite Bourgeoys, la fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame et la première, parmi les immigrantes de la colonie, à être sanctifiée. Les filles séculières de Marguerite Bourgeoys, de concert avec les religieuses ursulines, mettent en place l’infrastructure scolaire en Nouvelle-France, tout comme les Hospitalières de Québec et de Montréal le font en matière de santé. Ces femmes bien nées créent le premier système canadien de services sociaux.
À considérer le rôle important joué par ces religieuses, on aurait tendance à croire que toutes les immigrantes sont, sinon des dévotes, du moins des catholiques. Tel n’est pas le cas. Au moins quelques dizaines d’entre elles ont été élevées dans la religion huguenote, ce qui fait qu’il y aurait deux fois plus de femmes que d’hommes de confession protestante.
Une travestie juive au Canada
Le cas le plus spectaculaire de diversité religieuse parmi les immigrantes n’est pas celui d’une huguenote, mais bien celui d’une juive. Il s’agit d’Esther Brandeau, « âgée d’environ vingt ans, laquelle s’est embarquée en qualité de passager en habit de garçon sous le nom de Jacques Lafargue ». Esther, qui se présente comme « fille de David Brandeau, juif de nation négociant au Saint‑Esprit… près Bayonne », explique les circonstances peu orthodoxes de son arrivée dans la colonie :
« Qu’il y a cinq ans que son père et sa mère la firent embarquer audit lieu… pour l’envoyer à Amsterdam à une de ses tantes et à son frère, que le navire s’étant perdu sur la barre de Bayonne dans… 1733, elle s’est heureusement sauvée à terre avec un des gens de l’équipage, qu’elle fut retirée par… [une] veuve demeurant à Biarritz, que quinze jours après elle partit habillée en homme pour Bordeaux où elle s’embarqua en qualité de coq, sous le nom de Pierre Mansiette sur une barque… destinée pour Nantes, qu’elle retourna sur le même bâtiment à Bordeaux où elle s’embarqua de nouveau en la même qualité sur un bâtiment espagnol… qui partait pour Nantes, qu’arrivée à Nantes elle déserta et s’en alla à Rennes où elle se plaça en qualité de garçon chez un… tailleur d’habits où elle resta six mois, que de Rennes elle alla à Clisson où elle entra au service des Récollets en qualité de domestique et pour faire les commissions, qu’elle resta trois mois dans ce couvent dont elle sortit sans les avertir, pour aller à Saint‑Malo où elle trouva asile chez une boulangère… où elle resta cinq mois…, qu’elle alla ensuite à Vitré pour chercher quelque condition, là elle se mit au service… [d’un] ci‑devant capitaine au Régiment de la Reine Infanterie qu’elle a servi pendant dix à onze mois en qualité de laquais, qu’elle sortit de cette situation parce que sa santé ne lui permit pas de continuer à veiller ledit sieur…, ladite Esther revenant à Nantes… fut prise pour un voleur et arrêtée par la maréchaussée du lieu et conduite dans les prisons… où on la fit sortir au bout des vingt-quatre heures parce qu’on s’aperçut qu’on s’était mépris, elle se rendit ensuite à La Rochelle où ayant pris le nom de Jacques Lafargue elle s’est embarquée pour passager. »
Les autorités canadiennes enferment Esther à l’Hôpital général dans l’espoir de la convertir. Un an plus tard, exaspérées, elles abandonnent leur effort et choisissent de la déporter. De dire l’intendant : « Elle est si volage qu’elle n’a pu s’accommoder ni à l’Hôpital général ni à plusieurs autres maisons particulières où je l’avais fait mettre. La concierge des prisons en a pris soin en dernier lieu… Elle n’a pas tenu absolument une mauvaise conduite mais elle a tant de légèreté qu’elle a été en différents temps aussi docile que revêche aux instructions que des Ecclésiastiques zélés ont voulu lui donner; je n’ai pas d’autre parti à prendre que de la renvoyer. »
Esther rembarque pour La Rochelle à l’automne 1739. Nous ne savons malheureusement rien de son existence par la suite.
Pourquoi venir en Nouvelle-France? (afficher)
Quitter « la douce France ». Endurer une longue et pénible traversée où le risque de mortalité est de 5 p. 100 environ. Débarquer dans un pays aux forêts immenses, à l’hiver rude et, par surcroît, peuplé de redoutables guerriers. Pourquoi émigrer en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles et encourir de tels périls?
Migration de misère ou de prospérité?
La difficulté de l’entreprise coloniale fait dire à certains historiens que la misère est la cause principale de la migration. L’historien français Robert Mandrou est de ceux-là. Il explique les départs depuis La Rochelle en évoquant les périodes de troubles, de famine, de crise : « Les engagés ne sont donc venus volontiers dans le port de La Rochelle qu’au cours des années difficiles. »
En analysant ces mêmes départs, Louis Pérouas, spécialiste de l’histoire urbaine, les relie plutôt « à des périodes où La Rochelle connaît, tout à la fois, un coût de vie modéré et un commerce maritime en expansion ». Il arrive donc à la conclusion opposée : « l’exode colonial prendrait presque la valeur d’un indice de prospérité ».
Sans nier la situation modeste de la plupart des immigrants, il faut donner raison à Pérouas au sujet du contexte économique de la colonisation : elle a lieu dans une période d’expansion du commerce atlantique français aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il est aussi significatif que les rares immigrants à formuler leurs motivations insistent sur les possibilités qu’offre l’émigration plutôt que sur leur situation désespérée. En témoigne Jean Galon, fils d’un maçon et couvreur normand qui s’embarque pour Louisbourg « dans l’espérance d’y mieux gagner sa vie », ou Jean-Baptiste Lascorret, jeune commis d’un marchand de Bayonne, qui trouve « plus avantageux de venir en cette île (le cap Breton) où on lui faisait espérer de faire dans peu une petite fortune ».
Le contexte migratoire
Lorsqu’il étudie les départs vers la colonie depuis La Rochelle, Louis Pérouas remarque la coïncidence entre les pics d’émigration et les années de forte migration vers cette ville : « Une même influence a joué dans les deux mouvements, l’attirance même de la cité rochelaise. »
Le lien entre les arrivées et les départs est en effet étroit. Pour un grand nombre d’émigrants, le voyage en Nouvelle-France ne survient qu’après une première migration : il s’inscrit dans d’autres traditions migratoires. Un immigrant, dans une ville portuaire, peut décider, après un séjour, bref ou prolongé, de tenter sa chance dans la colonie. Un soldat peut s’embarquer, comme militaire ou comme engagé, après avoir fait la navette entre des villes casernes pendant six ou sept ans. Des migrants montagnards peuvent interrompre leur voyage saisonnier dans une grande ville pour aller travailler à Louisbourg ou à Québec. Des compagnons artisans peuvent couper court à leur Tour de France pour aller y exercer leur métier. (On appelle « Tour de France » les déplacements qu’effectuent de jeunes artisans approchant la fin de leur formation professionnelle; ces derniers « voyagent la France » selon des itinéraires plus ou moins structurés.) L’immigration en Nouvelle-France est donc, dans ces cas, le prolongement des courants migratoires traditionnels en France, lesquels contribuent ainsi directement à la mobilité transatlantique.
L’urbanisation, ou le mouvement continu de la population rurale vers les villes, caractérise la population française bien avant l’ère industrielle. Les villes de cette époque sont des lieux malsains, où le nombre de décès excède de beaucoup celui des naissances, de sorte qu’elles ont besoin de l’immigration simplement pour maintenir leur population. L’immigration en provenance des campagnes proches, dans un rayon de 20 kilomètres environ, est autant le fait de femmes que d’hommes. Plus loin de la ville, l’élément féminin se raréfie. Les migrants régionaux et interrégionaux, temporaires ou permanents, sont généralement des jeunes hommes à la recherche de travail. Même mariés, ils voyagent sans leur famille, ce qui est assez souvent le cas chez les travailleurs saisonniers.
Toutes ces formes d’exode rural sont présentes chez les émigrants vers la Nouvelle-France. De la campagne autour de Paris partent des domestiques et des artisans pour la ville, pour ensuite, dans une deuxième étape, faire le voyage vers la colonie. Le cuisinier Alexandre Picard, du village de Mesnil-Saint-Georges en Picardie, la servante Jeanne Godin d’Aunay, près de Vire en Normandie, et Ambroise Leguay dit La Grenade, « natif de Coubron à 4 Lieues de paris doreur et argenteur », sont quelques exemples. De plus loin encore, des montagnards traversent l’Atlantique après avoir travaillé dans la grande ville. Parmi les Auvergnats, on peut citer Pierre Rivet, porteur d’eau, fils d’un « journalier et terrien », originaire d’un village près de (du) Puy. Arrivé à Paris à l’âge de 17 ans, il exerce ce métier traditionnel pendant 15 ans avant de s’engager dans les troupes du Canada où, après des expériences comme soldat et journalier, il pratique une autre spécialité auvergnate, la chaudronnerie. On trouve en Acadie et au Canada des maçons du Massif central, comme André Le Comte dit Vadeboncœur, un natif d’Azérables, dans la Creuse, venu à Paris comme aide-maçon à l’âge de 15 ans. Il habite pendant 10 ans, rue de la Mortellerie, près des embaucheurs de la place de la Grève, avant de s’engager, lui aussi, dans les troupes. Des Alpes, à partir de La Rochelle, arrivent des immigrants aux métiers également typiques. Pierre Pechereau, qui s’engage en 1755, est un ramoneur savoyard, et le marchand François Viennay-Pachot vient de l’Oisans, une pépinière de colporteurs urbains.
Les mouvements interurbains sont aussi importants que l’exode rural dans les migrations de l’Ancien Régime. Les villes françaises se rattachent à l’extérieur par deux réseaux migratoires, l’un prenant ses origines dans les campagnes; l’autre, dans cette « seconde patrie des citadins » que sont les autres villes. La plupart des citadins mobiles sont des jeunes hommes célibataires. Certains participent même à ce qu’on peut appeler « l’hypermobilité » interurbaine parce qu’ils vont de ville en ville pendant des années. Le Tour de France ainsi que l’autre « école de mobilité » qu’est l’armée rassemblent un grand nombre de migrants hypermobiles aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Comme l’exode rural, la migration interurbaine est souvent un prélude à l’émigration en Nouvelle-France. À titre d’exemples, on peut citer Jacques Joseph Le Geay dit Printemps, « natif de Noyon en Picardie et habitant de Paris », et Emmanuel Bergeron, né dans la ville de Saint-Germain-en-Laye et travaillant comme garçon boulanger à Paris, rue de la Draperie. Le Geay, 39 ans, dont la femme est à Paris à l’époque de son engagement, conçoit peut-être son séjour dans la colonie comme étant temporaire, le temps d’amasser un petit pécule. Quant aux soldats et aux compagnons, certains ont déjà suivi un itinéraire interurbain complexe. En 1757, le soldat Joseph Pusse dit Lalime, fondeur natif de la ville de Namur, en Belgique, présente comme témoins de sa liberté au mariage des soldats canadiens qui l’ont connu à Port-Louis (Morhiban), à Paris et à Liège. L’année suivante, le compagnon parisien Antoine Boudin dit Saint-Germain témoigne en faveur du fils de son ancien maître chez qui il est demeuré « cinq ans pour y apprendre Le metier de maçon après quoi ayant fait son tour de France pandt près de 3 ans il s’est engagé a Bordeaux ».
Les courants traditionnels de la mobilité interne alimentent ainsi l’immigration transatlantique, laquelle se trouve carrément au confluent de flux migratoires connus.
Comment recruter des colons? (afficher)
Les diverses filières migratoires existantes ne suffisent pas toutefois à garantir un flux important d’immigrants à la Nouvelle-France et encore moins à les y retenir. À cause des hivers rudes, des saisons agricoles courtes, des guerres avec les Iroquois, d’un développement économique lent, le Canada n’est jamais perçu en France comme un El Dorado. En fait, on doit généralement persuader les gens d’y émigrer. Voyons qui les persuade et à quelles techniques on a recours.
Le système de recrutement repose sur les secteurs public et privé. Dans le secteur privé, des habitants et des marchands enrôlent des passagers et des engagés en insistant sur la disponibilité des terres et sur les gages intéressants. Pour leur part, les fonctionnaires, souvent affiliés au ministère de la Marine, recrutent des soldats, des ouvriers spécialisés, des filles à marier et des criminels peu dangereux, tels les braconniers et les faux-sauniers. Ces recrues forment donc un groupe bien bigarré. Parmi les criminels, déportés sans leur consentement, bon nombre essaient de revenir chez eux malgré leur condamnation à vie. Les soldats et les ouvriers, comme les engagés et les passagers recrutés par des particuliers, viennent dans le but d’obtenir un travail continu et bien rémunéré, et peut-être aussi pour s’établir. Des jeunes filles sans dot profitent de cette occasion inattendue de se marier.
Les habitants recruteurs
Le recrutement effectué par les habitants de la colonie a souvent un caractère personnel. Des colons satisfaits écrivent à leurs amis et aux membres de leur famille pour les inviter à les y rejoindre. D’autres, qui ont besoin de main-d’œuvre, se rendent en France à la recherche de candidats. Si le voyage en France est impossible pour différentes raisons, ils transmettent leurs demandes à une personne fiable sur place.
Ceux qui veulent peupler une seigneurie doivent recruter sur une plus grande échelle. Toutefois, même s’ils ne dédaignent pas les grands ports, les premiers seigneurs de l’Acadie et du Canada adoptent souvent une approche plus locale. Leurs propres régions d’origine fournissent donc un nombre considérable de recrues. Parce qu’ils mettent l’accent sur la mise en valeur de leurs terres, ils s’efforcent d’enrôler des familles entières et des campagnards. Pour cette raison, les seigneurs, dont des communautés religieuses, sont responsables du recrutement d’une bonne partie des immigrants fondateurs.
Un cas de recrutement seigneurial : les immigrants du Perche
Un recrutement très réussi est celui de Robert Giffard, seigneur de Beauport. Descendant d’une famille bourgeoise des environs de Mortagne, au Perche, Giffard se rend en Nouvelle-France comme chirurgien de navire dans les années 1620, puis retourne à Mortagne où il est maître apothicaire. En 1634, il s’installe au Canada après avoir demandé et reçu une seigneurie.
Les principaux associés de Giffard sont les frères Jean et Noël Juchereau, fils d’un marchand et industriel de la région qui a fait fortune dans le commerce (vin, bois, fer, terres, etc.). Leur participation à la colonisation leur vaut non seulement des avantages financiers, mais aussi un meilleur statut social. Nicolas, fils de Jean, recevra des lettres de noblesse en 1692.
Les initiatives de ces trois recruteurs vont amener en Nouvelle-France plus de 200 colons de Perche dans les 30 années qui suivent. Les immigrants percherons, en tant que propriétaires fonciers voyageant souvent en famille, s’enracinent particulièrement bien au Canada. Gagnon, Boucher, Tremblay — les fondateurs de ces importantes lignées québécoises étaient percherons.
Le travail de recrutement des marchands et des fonctionnaires
Les marchands qui font le commerce des engagés et les fonctionnaires au service de la Couronne recrutent les immigrants de façon assez différente. Les premiers sont des professionnels qui accordent peu d’attention à la qualité des personnes dont ils organisent le transport. Des affiches et des roulements de tambour annoncent leur présence sur la place publique, le plus souvent dans une grande ville. Ensuite, ils ratissent aussi large que possible. Sur une affiche produite par les négociants du Havre pour promouvoir les colonies antillaises, on promet le titre de maître aux artisans qui s’engageront; du bois, des outils et des animaux, aux cultivateurs; le mariage et un métier (celui de fileuse), aux femmes; et, à chacun, autant de terre qu’il leur sera possible de cultiver. On offre aussi une prime d’engagement mais, dans la pratique, elle est presque toujours déduite des gages que l’immigrant reçoit dans la colonie.
Seulement deux catégories d’immigrants échappent à cette méthode anonyme de recrutement : les filles du roi et les prisonniers. Dans ces deux cas, des recruteurs engagés par la Couronne cherchent des immigrants dans des groupes bien précis. Quand Louis xiv prend en main la Nouvelle-France, en 1663, le bilan des départs féminins est moins que satisfaisant. Les femmes comptent pour environ le tiers de la population blanche et il y a sept hommes pour une seule Française mariable. Afin de remédier à cette situation si néfaste au peuplement, l’État envoie les filles du roi. De 1663 à 1673, plus de 800 femmes en état de se marier gagnent le Canada moyennant une dot.
Les filles du roi viennent en premier lieu de l’Hôpital général de Paris, dont le directeur en chef, Christophe du Plessis de Montbard, s’intéresse depuis longtemps au Canada. Fondé en 1656, l’établissement abrite environ 3000 femmes et filles dans son annexe féminine de la Salpêtrière : des malades, des folles, des orphelines indigentes et même des filles de bonne famille. Le gentilhomme sans fortune peut y placer sa fille comme dans un couvent à bon marché, et l’Hôpital est heureux de recevoir ce « bijou » qui, malgré sa gêne financière, hausse la réputation de l’établissement. On n’exclut de la Salpêtrière, en principe, que les femmes dont les mœurs suspectes les disqualifient de l’assistance publique.
L’intendant du roi en Nouvelle-France, Jean Talon, participe au recrutement des filles du roi parmi les pupilles de l’Hôpital lors d’une visite en 1673. Les directeurs ont déjà fait un premier choix parmi les filles, en se basant sur leurs inclinations et leurs aptitudes; cette liste est ensuite soumise aux autorités coloniales pour ratification. À leur départ, elles reçoivent un petit trousseau d’une dizaine de livres, qui comprend une cassette, une coiffe, un mouchoir de taffetas, une ceinture, des rubans à souliers, cent aiguilles et un dé, un peigne, du fil blanc et gris, une paire de bas, des souliers, une paire de gants, des ciseaux, un millier d’épingles, un bonnet et des lacets.
Les filles du roi se marient tôt après leur arrivée dans la colonie, devenant ainsi des immigrantes fondatrices. On estime que tous les Québécois de souche ont une fille du roi parmi leurs ancêtres.
Les prisonniers, par contre, s’adaptent plutôt mal à leur nouveau pays. Sur le millier à gagner le Canada et l’Île Royale, dans les années 1720, 1730 et 1740, à peine une centaine seront des immigrants fondateurs. La plupart d’entre eux sont des faux-sauniers, c’est-à-dire des contrebandiers qui ont fait le commerce du sel sans s’acquitter de la taxe, la gabelle. Choisis par les directeurs de prison ou d’autres responsables en fonction de critères tels que la condition physique, le métier, l’âge et le statut matrimonial, ils ne peuvent refuser leur déportation.
Le faux-saunier Pierre Revol, déporté au Canada en 1739, sert dans les troupes jusqu’à son mariage, en 1744, avec une fille de marchand. Devenu marchand lui-même et voulant entreprendre un voyage d’affaires, il demande au gouverneur de solliciter la révocation de sa condamnation auprès des autorités françaises. Las d’attendre, il arme son navire et part, en 1748, pour la Martinique. Quand le gouverneur essaie de le faire arrêter, il menace ses poursuivants de ses huit canons. Arrivé en Martinique, Revol vend sa cargaison, puis recharge aussitôt son navire. Il est déjà en route pour Bordeaux quand arrive l’ordre de l’arrêter. De Bordeaux, il passe à Marseille, où les autorités l’attendent. Mis en prison et déporté une deuxième fois en Nouvelle-France, il s’en tire avec six mois supplémentaires d’emprisonnement.
Comment peupler la Louisiane? (afficher)
Si les régions de Détroit et du pays des Illinois ont été peuplées surtout à partir du Canada, tel ne fut pas le cas de la Louisiane. À la mort de Louis xiv, en 1715, l’émigration française vers cette colonie fondée en 1699, est minime. Les conditions de vie sont très difficiles pendant la guerre de Succession d’Espagne (1702-1713), ce qui ne tarde pas à donner à la Louisiane une mauvaise réputation dans les ports atlantiques. En 1704, les 22 filles à marier en partance pour cette colonie tentent en vain de déserter après avoir entendu toutes sortes d’horreurs à son sujet au port de Rochefort. En 1715, la Louisiane compte moins de 300 personnes, dont 160 militaires français et quelques Canadiens. La situation change toutefois rapidement pendant la Régence. L’État adopte d’abord le principe de l’émigration forcée, préalablement rejeté par le ministre de la Marine. Cette nouvelle politique est mise en œuvre dès 1717, année de la cession du monopole de la colonie à la Compagnie d’Occident de John Law.
La première étape consiste à chercher, dans les provinces du Maine, de Touraine et d’Anjou, des faux-sauniers que l’on juge aptes à travailler la terre. Soixante-cinq hommes sont ainsi choisis en 1716, mais leur embarquement est retardé à cause du transfert du monopole qui se prépare. En attendant leur départ, ils connaissent des mois difficiles qui ne font qu’aggraver la mauvaise réputation de la colonie.
En 1719 et en 1720, l’État étend sa politique de déportation aux vagabonds et aux gens sans aveu (sans emploi) des principales villes du royaume, en commençant par Paris. Un corps d’archers est même formé pour les arrêter; les abus que commettent ces derniers déclenchent de sérieuses émeutes contre « l’esclavage louisianais ».
Après les émeutes, le roi met fin à l’émigration forcée, dont le bilan laisse à désirer. De 1717 à 1720, on déportera 1300 hommes et 160 femmes, mais seul un petit nombre d’entre eux participera au peuplement de la colonie. Cette expérience discrédite davantage le Mississippi auprès des Français, surtout dans les grandes villes et les ports qui servent de réservoirs naturels à l’immigration coloniale.
La compagnie de Law ne se borne cependant pas à transporter des immigrants de force : elle orchestre aussi une propagande effrénée afin de susciter l’émigration volontaire. Toutefois, cette campagne exagérée qui présente la Louisiane comme un paradis terrestre se révèle infructueuse. Les 300 artisans recrutés par la compagnie dans les ports atlantiques, entre 1717 et 1721, viennent pour la plupart du Midi où, apparemment, la mauvaise réputation de la colonie est moins bien ancrée.
En revanche, traduits en allemand, les prospectus de Law font sensation dans la vallée du Rhin où, pendant ces mêmes années, 4000 personnes acceptent de s’engager pour la Louisiane. Comble de malheur, des 4000 Allemands qui se rendent au port de Lorient, la moitié meurent des suites d’une épidémie et 500 désertent pour rentrer chez eux. Des 1300 qui s’embarquent enfin, 500 meurent pendant la traversée et 500, à l’arrivée. Il ne reste que 300 survivants, qui feront souche et deviendront en peu de temps des colons très prospères.
L’émigration française vers la Louisiane cesse à peu près en 1721, après l’effondrement du système de Law. De concert avec les Allemands, on réussit à transporter plus de 4000 immigrants volontaires dans la colonie, dont 1000 reviennent en France le plus vite possible. Il faut ajouter à ce nombre un millier de soldats, des Français et des Suisses du régiment de Karrer, qui sont surtout des immigrants temporaires.
Conclusion (afficher)
La Nouvelle-France accueille aux XVIIe et XVIIIe siècles une population dont les caractéristiques la distinguent de la population française prise dans son ensemble. Les réseaux urbains et commerciaux ainsi que les filières migratoires déjà constituées opèrent une sorte de sélection, d’où le profil démographique singulier, dominé par les jeunes artisans, des premiers noyaux francophones en Amérique du Nord. L’émigration se fait lentement, d’où l’importance d’un système de recrutement à la fois public et privé. Sauf exception, les Français, et surtout les Françaises, ne se ruent pas vers cette route d’exil. Pour ceux et celles qui la choisissent quand même, l’aventure nord-américaine leur apporte, grâce au mariage, à l’établissement sur une terre ou à l’accumulation d’un certain pécule, la sécurité financière économique qui leur échappait en France.
Beaucoup d’immigrants ne demeurent pas en Nouvelle-France. Des 33 500 venus au Canada, moins de 10 000 y restent. Aujourd’hui, ces derniers sont considérés comme étant les immigrants fondateurs. Évidemment, la guerre de la Conquête y est pour quelque chose. Sans compter les soldats de la guerre de Sept Ans, dont à peine 15 p. 100 s’établissent dans la colonie, plus de 4000 habitants du Canada repartent en France à la fin du Régime français. Dans les Maritimes, la situation est pire en raison de la déportation, par les Anglais, de plus de 10 000 Acadiens et du rapatriement forcé des habitants de l’Île Royale et de l’Île Saint-Jean (aujourd’hui les îles du Cap-Breton et du Prince-Édouard). Que ce soit au Canada ou dans les Maritimes, la Conquête marque le début d’une ère nouvelle dans le peuplement européen, dominé cette fois par les Britanniques. Ceux qui restent, bénéficiant du renfort des Acadiens rescapés ou revenus du Grand Dérangement, perpétuent l’héritage français. Aujourd’hui, ils ont plus de 10 millions de descendants en Amérique du Nord.
Pistes de lecture (afficher)
ALLAIN, MATHÉ. « L’immigration française en Louisiane, 1718-1721 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 28 (1975), p. 555-564.
BÉDARD, MARC-ANDRÉ. Les protestants en Nouvelle-France, Québec : La Société historique du Québec, 1978. Cahiers d’histoire, no 31.
BOLEDA, MARIO. « Trente mille Français à la conquête du Saint-Laurent », Histoire sociale/Social History, vol. 23 (1990), p. 153-177.
CARPIN, GERVAIS. Le réseau du Canada. Étude du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France (1628-1662), Sillery, Qc : Septentrion; Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001.
CHARBONNEAU, HUBERT. Vie et mort de nos ancêtres. Étude démographique, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1975.
CHARBONNEAU, HUBERT, et al. Naissance d’une population. Les Français établis au Canada au XVIIe siècle, Paris : Institut national des études démographiques; Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1987.
CHOQUETTE, LESLIE. De Français à paysans. Modernité et tradition dans le peuplement du Canada français, Sillery, Qc : Septentrion; Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001.
DECHÊNE, LOUISE. Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Paris : Plon, 1974.
DUPÂQUIER, JACQUES, dir. Histoire de la population française, vol. 2, De la Renaissance à 1789, Paris : Presses universitaires de France, 1988.
FOURNIER, MARCEL. Les Européens au Canada des origines à 1765, Montréal : Éditions du fleuve, 1989.
FOURNIER, MARCEL, dir. Combattre pour la France en Amérique. Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, 1755-1760, Montréal : Société généalogique canadienne-française, 2009.
JETTÉ, RENÉ. Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1983.
LANDRY, YVES. Les filles du roi au XVIIe siècle. Orphelines en France, pionnières au Canada, Ottawa : Leméac, 1992.
LANDRY, YVES, dir. Le peuplement du Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles. Actes des premières journées d’étude du Programme de recherche sur l’émigration des Français en Nouvelle-France (PRÉFEN), Caen : Centre de recherche d’histoire quantitative, 2004.
LARIN, ROBERT. Brève histoire du peuplement européen en Nouvelle-France, Sillery, Qc : Septentrion, 2000.
MANDROU, ROBERT. « Les Français hors de France aux XVIe et XVIIe siècles », Annales. Économies, sociétés, civilisations, vol. 14 (1959), p. 662-675.
MOOGK, PETER N. La Nouvelle France. The Making of French Canada—A Cultural History, East Lansing, MI : Michigan State University Press, 2000.
PÉROUAS, LOUIS. « Sur la démographie rochelaise », Annales. Économies, sociétés, civilisations, vol. 16 (1961), p. 1131-1140.
VAUGEOIS, DENIS. Les Juifs et la Nouvelle-France, Trois-Rivières : Boréal Express, 1968.